
Vitrine de la modernisation agricole, le Plan Maroc Vert a dopé les exportations et gonflé les recettes en devises. Mais ce succès apparent cache une équation inquiétante, des prix alimentaires qui flambent pour les Marocains, des nappes phréatiques qui s’assèchent, des sols qui s’érodent. Exporter plus, oui, mais à quel prix pour l’eau, les terres et la souveraineté alimentaire du pays ?
Lancé en 2008 par le ministère de l’Agriculture à l'époque Aziz Akhannouch, le Plan Maroc Vert (PMV) avait pour ambition de faire de l’agriculture le moteur de croissance nationale. Structuré en deux piliers : le premier tourné vers une agriculture moderne à forte valeur ajoutée, le second consacré à une agriculture solidaire pour les petits exploitants. Il a marqué un tournant dans la politique agricole du Royaume. L’Agence pour le développement agricole (ADA), créée en 2009, en a assuré la mise en œuvre.
En un peu plus d’une décennie, le Plan Maroc Vert a changé le visage de l’agriculture marocaine. Le bilan officiel est flatteur : entre 2008 et 2020, les exportations agricoles ont été multipliées par près de trois, passant de 15 à 41 milliards de dirhams. Le revenu agricole par actif a progressé de 47 %, et les superficies plantées en olivier ont doublé, propulsant le Maroc parmi les grands producteurs méditerranéens. Pourtant, cette expansion n’a pas empêché la flambée des prix des produits agricoles sur le marché local, 1 litre d’huile d’olive se vend aujourd’hui entre 110 et 120 dirhams, un paradoxe qui illustre la fragilité du modèle.
Ces succès ont modernisé le secteur et généré des devises. Mais derrière l’envolée des chiffres se cachent deux prix : un prix environnemental et un prix social. L’agriculture accapare 85 % des ressources en eau. Certes, 585 000 hectares ont été convertis au goutte-à-goutte, mais les nappes restent déficitaires de 4 milliards de m³ chaque année. L’érosion hydrique emporte chaque année 100 millions de tonnes de sols, fragilisant 40 % des terres cultivées. Sur le plan social, le marché local souffre : alors que la production oléicole explose, l’huile d’olive reste inaccessible pour beaucoup de foyers. Le Maroc a même dû importer de l’huile d’olive du Brésil, ainsi que des moutons de l'Australie, de l'Espagne et de la Roumanie pour compenser la baisse du cheptel depuis 2016. Une équation paradoxale : utiliser une eau rare pour nourrir les marchés étrangers, alors que l’autosuffisance alimentaire reste fragile et que l’inflation pèse lourdement sur les ménages marocains.
Pour répondre à cette crise hydrique, l’État a misé principalement sur deux solutions techniques. Les transferts d’eau du Nord vers le Centre et le Sud, les fameuses « autoroutes de l’eau », comme le projet Sebou–Bouregreg, permettent d’alimenter temporairement des régions arides. Mais si la pluie se raréfie aussi dans le Nord, ces conduites resteront vides. Le dessalement de l’eau de mer, en revanche, pourrait assurer une ressource quasi illimitée grâce aux deux façades maritimes, l’Atlantique et la Méditerranéenne. Mais cette option génère d’autres problèmes : elle est extrêmement énergivore et rejette une saumure concentrée qui menace les écosystèmes marins. Autrement dit, le dessalement n’est pas une solution miracle, mais un déplacement des contraintes écologiques.
Le Maroc tente par ailleurs de mobiliser des financements verts. Le Fonds vert pour le climat a accordé plus de 39 millions de dollars pour des projets d’irrigation et de résilience, portés par l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et l’ADA. Et un Plan d’investissement vert de 25 milliards de dollars à l’horizon 2030 place l’agriculture parmi les secteurs stratégiques de décarbonation. Mais ces initiatives restent marginales face aux milliards déjà investis dans les cultures d’exportation.
Le contexte climatique rend cette transition urgente. Depuis 1960, les températures moyennes au Maroc ont augmenté de 1,5 °C, tandis que les précipitations ont reculé de 15 %. Le pays figure parmi les plus exposés aux effets du changement climatique en Méditerranée.
Le Plan Maroc Vert restera comme un jalon majeur de la modernisation agricole. Mais vu sous l’angle du développement durable, il révèle aussi la limite d’un modèle trop intensif et trop tourné vers l’export. L’avenir ne se joue pas uniquement sur la capacité à produire plus, mais à produire autrement, de façon plus sobre, plus résiliente et plus équitable. Nourrir davantage, oui, mais surtout nourrir localement et durablement et cette fois.
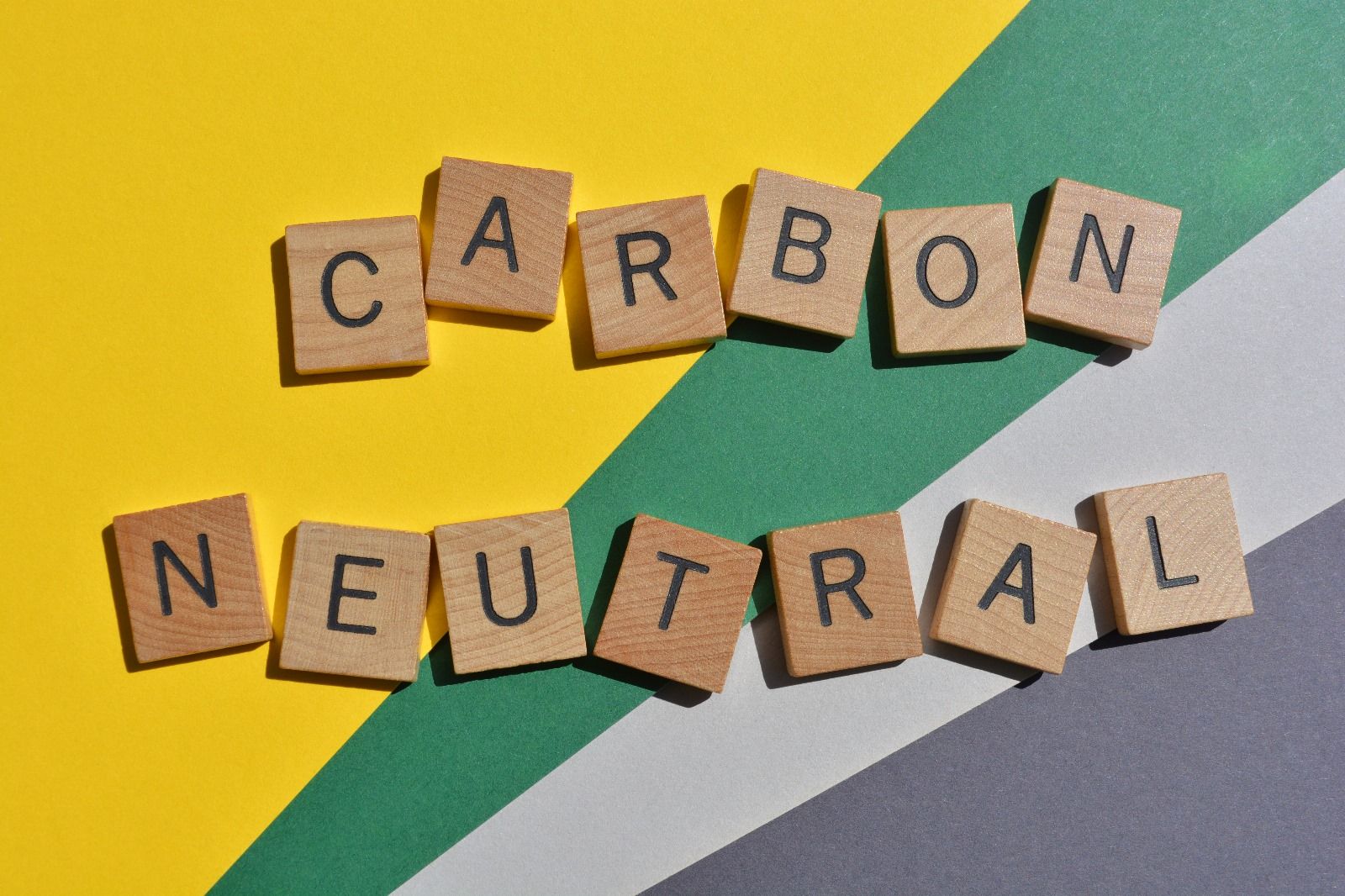
La Commission européenne a confirmé l’entrée en vigueur en 2026 du mécanisme d’a...

Le Maroc devient éligible au cadre de financement durable de la BID et peut leve...

Selon le recensement national du ministère de l’Agriculture, réalisé entre juin ...